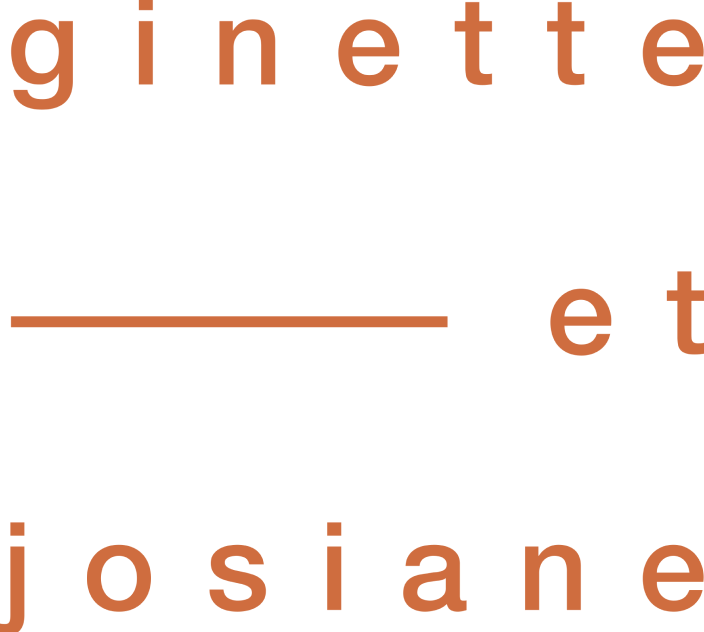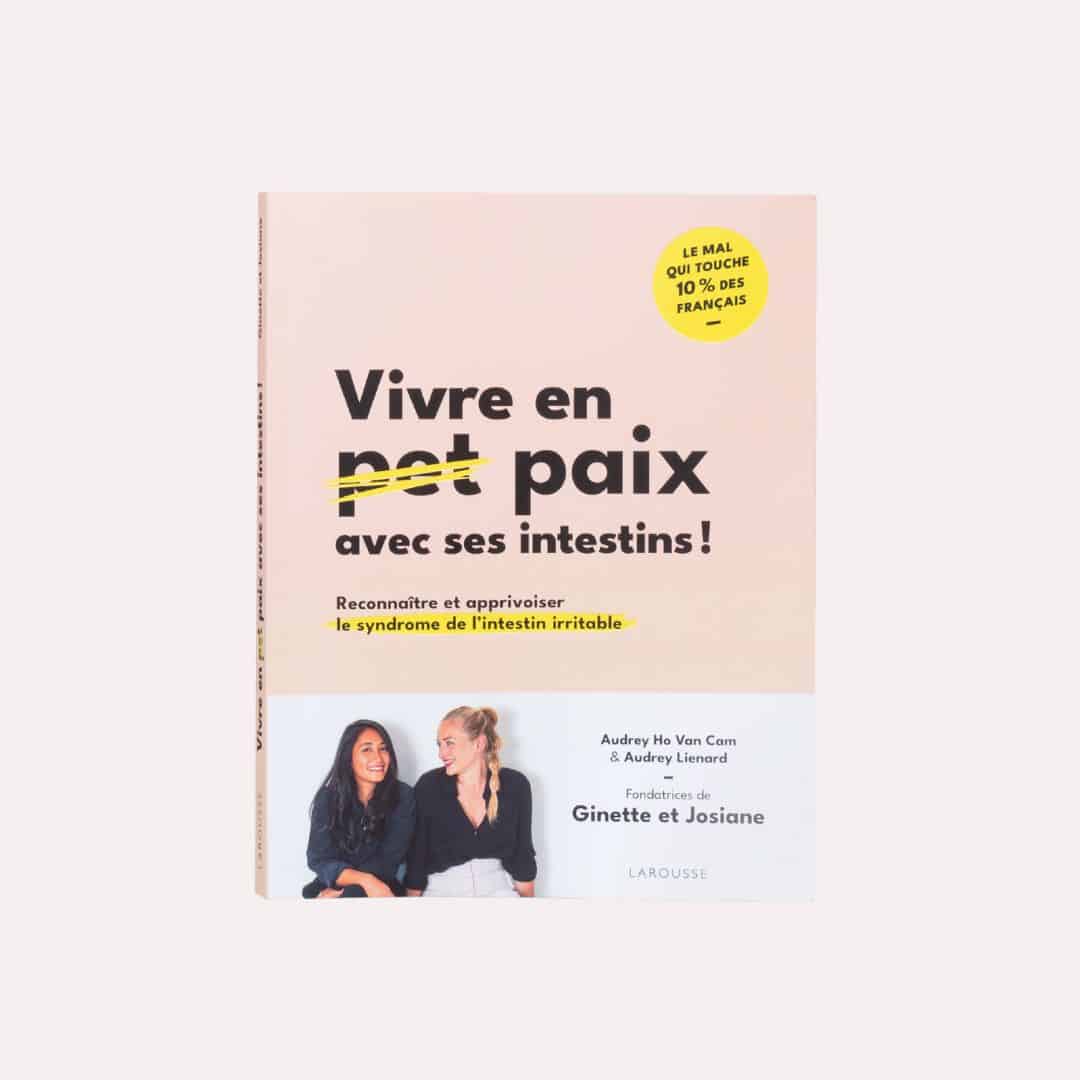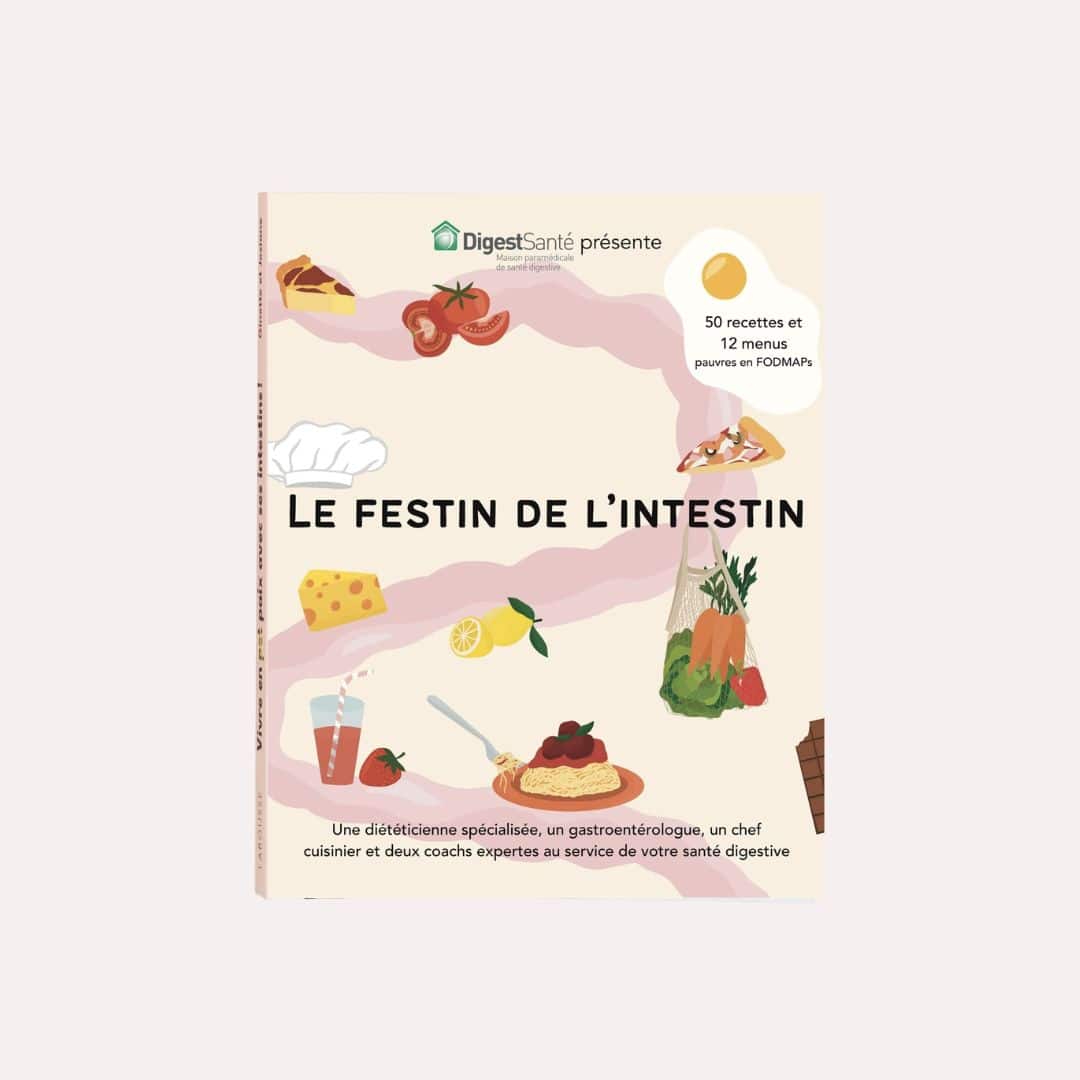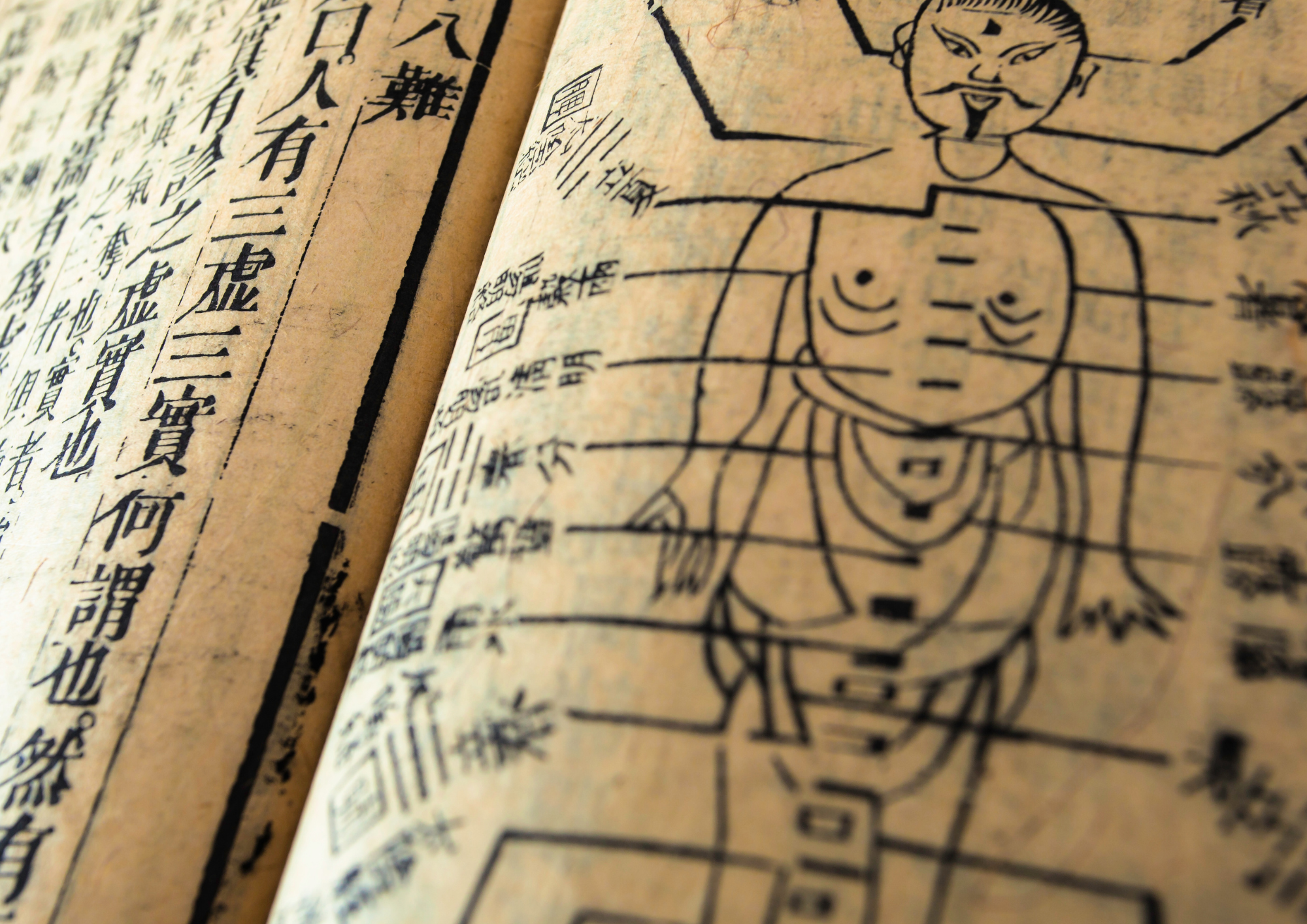TABLE DES MATIÈRES
- L’inflammation des intestins : de quoi s’agit-il réellement ?
- Dans quelle zone se localise l’inflammation intestinale ?
- Les différents types d’inflammations des intestins
- Les raisons qui peuvent causer une inflammation de l’intestin
- Qui sont les personnes à risques ?
- Comment se manifeste une inflammation des intestins ?
- Les traitements d’une inflammation des intestins
- Quels sont les risques de complication ?
- Mieux comprendre les Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI)
Une inflammation des intestins est une réaction qui se caractérise par une inflammation de différentes parties de l’organe. Cela est généralement possible en raison d’une dérégulation du système immunitaire qui aboutit à différentes pathologies des intestins. Pouvant être chroniques ou aiguës, ces dernières ont des origines diverses. Il convient donc de les connaître afin d’éviter certains pièges. Cause, symptôme et traitement, voici ce que vous devez savoir sur l’inflammation de l’intestin.
L’inflammation des intestins : de quoi s’agit-il réellement ?
Localisée au niveau de la paroi intestinale, ce type d’inflammation n’est rien d’autre qu’une réaction du système immunitaire. Elle survient la plupart du temps suite à une hyperactivité dudit système et peut être considérée comme aiguë ou chronique compte tenu de son origine et de son évolution. Dans le premier des cas, c’est lorsque l’inflammation est soudaine et transitoire. Par contre, l’inflammation est chronique lorsqu’elle est persistante. Il s’agit dès lors de Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI). Les deux plus courantes étant la maladie de Crohn (MC) et la rectocolite hémorragique (RH).
Les MICI concernent plus précisément la paroi d’une partie du tube digestif. Sur le long terme, elles deviennent incontrôlables et conduisent sur des lésions tissulaires ainsi que sur la chronicité de la maladie.
Dans quelle zone se localise l’inflammation intestinale ?
Il faut savoir qu’une inflammation de l’intestin peut se développer dans les différentes structures des deux types d’intestins. Au niveau de l’intestin grêle, on retrouve le duodénum, le jéjunum et l’iléon. Quant au colon (encore appelé gros intestin), on retrouve le cæcum, l’appendice et le rectum.

Les différents types d’inflammations des intestins
Une inflammation des intestins est une réaction qui cible très particulièrement des zones précises. Compte tenu de la localisation au niveau des intestins, on enregistre différentes catégories d’inflammation :
- la colite : inflammation du côlon ;
- l’appendicite : inflammation de l’appendicite ;
- l’entérite : inflammation de l’intestin grêle ;
- la typhlite : inflammation du cæcum ;
- l’iléite : inflammation de l’iléon ;
- la duodénite : inflammation du duodénum ;
- la jéjunite: inflammation du jéjunum ;
Cependant, sachez que chez de nombreux patients, il est possible que l’inflammation soit localisée simultanément dans plusieurs zones de l’organisme. Il peut s’agir notamment de :
- la gastro-entérite : inflammation de l’estomac et de l’intestin grêle ;
- la maladie de Crohn : pathologie chronique inflammatoire des intestins affectant l’intégralité des intestins. Elle peut affecter différentes parties du corps telles que le rectum, la cavité buccale et le canal anal ;
- l’entérocolite : inflammation de l’intestin grêle et du côlon ;
- la rectocolite hémorragique : connue également sous le nom de colite ulcéreuse, il s’agit également d’une pathologie chronique inflammatoire des intestins, mais qui touche particulièrement le côlon et le rectum.
Les raisons qui peuvent causer une inflammation de l’intestin
Dans la plupart des cas, une inflammation aiguë des intestins est provoquée par une infection. L’origine de cette dernière peut quant à elle être bactérienne, virale ou parasitaire. On peut prendre pour exemple véritablement significatif, la gastro-entérite dont l’origine est une infection virale.
Quant aux inflammations chroniques, donc les MICI, les raisons sont un peu plus compliquées à déceler. En effets, de nombreux facteurs sont susceptibles d’influer sur l’apparition des MICI localisées sur la paroi du tube digestif. De nombreuses études scientifiques et génétiques sont par ailleurs parvenues à révéler qu’il existe des prédispositions génétiques à l’apparition de certaines maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Celle qui survient le plus souvent est la rectocolite hémorragique. Quoi qu’il en soit, il faut savoir que ces prédispositions ne sont pas héréditaires.
Toujours par rapport aux MICI, des facteurs environnementaux (surplus d’hygiène, alimentation, pollution…) pourraient entrer en ligne de mire. Par contre, leurs effets sur l’apparition d’une inflammation chronique sont assez flous. Cependant, ce qui est sûr, c’est que le tabagisme quant à lui est susceptible d’accroître les risques de la maladie de Crohn.
Qui sont les personnes à risques ?
En temps normal, l’inflammation de l’intestin ne concerne pas exclusivement une tranche d’âge. Toutefois, il semblerait que les cas de MICI sont le plus souvent diagnostiqués chez les jeunes ayant entre 20 et 40 ans. Ce qui n’exclut pas pour autant les enfants puisque 15 % d’entre eux en sont atteints.
Les 20 et 30 ans sont ceux auprès de qui se manifeste le plus souvent la maladie de Crohn. Entre 30 et 40 ans par contre, les chances de contracter une rectocolite hémorragique sont plus élevées. Résultat, un système digestif altéré.

Comment se manifeste une inflammation des intestins ?
Les symptômes d’une inflammation du côlon ou de l’intestin grêle sont extrêmement variables. Selon les cas, ils peuvent dépendre de l’évolution, de l’origine et de la gravité de l’inflammation. Quoi qu’il en soit, les principaux symptômes peuvent être :
- des diarrhées ;
- des douleurs intestinales ;
- des troubles digestifs ;
- l’apparition d’un abcès au niveau de la zone anale ou l’apparition d’une fissure anale ;
- et une sensation de pesanteur autour du ventre (comme symptôme difficile à associer directement à l’inflammation).
Les traitements d’une inflammation des intestins
Le traitement qu’il convient d’administrer en cas d’inflammation des intestins doit nécessairement être déterminé en tenant compte de la cause de l’inflammation et du symptôme le plus persistant. Malgré un diagnostic fiable, il faudra dans la foulée réaliser des examens complémentaires afin de l’approfondir ou de le confirmer. C’est en fonction des résultats qu’un traitement sera établi. Il se compose généralement de médicaments tels que des antibiotiques, des antidiarrhéiques, des antispasmodiques et des immunosuppresseurs.
Pour ce qui est d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin, aucun traitement curatif n’est disponible pour le moment. Cependant, les anti-inflammatoires lorsqu’ils sont suivis d’une bonne qualité de vie, permettent de garder le contrôle à long terme sur la maladie et sur l’état du côlon. Ils permettent également d’éviter que surviennent des poussées et accélèrent la cicatrisation des lésions du tube digestif.
Par ailleurs, les traitements médicamenteux peuvent n’avoir aucun effet sur certains patients. L’ultime recours dans ce cas est de passer par une opération chirurgicale. Celle-ci consiste à retirer le segment du tube digestif le plus affecté.
Quels sont les risques de complication ?
Généralement faciles à maîtriser lorsqu’elles sont prises en charge assez rapidement, les inflammations des intestins sont susceptibles de dégénérer. C’est pour cela qu’il est recommandé de suivre un traitement médical adéquat, au risque de voir l’inflammation s’accroître et toucher d’autres parties de l’organisme. À cela doit s’ajouter un suivi médical rigoureux en cas de MICI auquel cas les conséquences peuvent être relativement irréversibles sur le long terme. Même une suppression de la partie de la paroi système digestif parviendra difficilement à redresser la pente.
Mieux comprendre les Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI)
Considérée comme chronique lorsque l’inflammation est présente sur la durée, il faut savoir que celle-ci peut à l’issue de cela, aboutir à de sérieuses pathologies du côlon notamment.
Comment sont-elles diagnostiquées ?
Il faudra passer par différentes étapes s’appuyant sur des arguments cliniques avant d’établir un diagnostic fiable d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin. En effet, après avoir constaté le premier symptôme le spécialiste recommandera une analyse sanguine pour commencer. Les résultats révèleront soit une carence nutritionnelle, un état inflammatoire…
En fonction de l’appréciation du praticien, des examens d’imagerie peuvent venir appuyer les résultats de la prise de sang afin d’approfondir le diagnostic de la maladie inflammatoire. Il optera généralement pour une coloscopie qui est une technique ne nécessitant pas d’anesthésie générale. Celle-ci consiste à insérer dans l’anus un tube fin et souple ayant un système optique intégré. Cette technique lui permettra grâce au tube, de visualiser réellement la paroi intestinale afin d’identifier les lésions.
Par ailleurs, cette méthode n’est pas la seule. Le diagnostic peut également passer par d’autres examens d’imagerie dont une radiographie, un scanner, une échographie ou une imagerie par résonance magnétique.

Qu’en est-il réellement du traitement des MICI ?
Comme mentionné plus haut, une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (qu’il s’agisse du côlon ou de l’intestin grêle) ne dispose d’aucun traitement à proprement parler. Ceux disponibles sont uniquement symptomatiques. Lesquels symptômes sont traités comme pour toute autre symptôme d’une maladie inflammatoire chronique telle que la sclérose en plaques ou la polyarthrite rhumatoïde.
Pour soulager les poussées, les médecins peuvent prescrire un anti inflammatoire assez puissants comme les corticoïdes ou les 5-aminosalicyés. Dans le cas où les effets escomptés ne sont pas au rendez-vous, le praticien peut opter pour un immunomodulateur. Il peut également être nécessaire lorsqu’un traitement de fond doit être effectué. Son rôle est de ralentir les défenses immunitaires afin de freiner l’inflammation.
En ce qui concerne l’autre symptôme (la diarrhée) parmi les plus persistants, le médecin associe aux anti-inflammatoires, un traitement antidiarrhéiques. À juste titre, puisqu’une diarrhée répétée est susceptible de décupler la douleur et le sentiment d’inconfort. En plus de la diarrhée peuvent apparaître des douleurs au bas du ventre.
Comme dans le cas d’une inflammation aiguë, le dernier recourt en cas de complication ou lorsque les traitements par symptôme n’ont aucun effet dans le cas des MICI, une intervention chirurgicale est de mise. Celle-ci vise à supprimer la zone intestinale touchée (il peut s’agir du côlon et du rectum dans le cas de la rectocolite hémorragique).
Articles phare
Vivre en paix avec ses intestins
Vivre en paix avec ses intestins Ballonnements, gaz, douleurs au ventre, digestion lente, problèmes de transit… Cela vous dit quelque chose ? Comme 10 % des Français, vous souffrez peut-être du syndrome de l’intestin irritable (SII). Encore assez méconnu, difficile à diagnostiquer, avec des symptômes variables, voire opposés d’une personne à l’autre, le SII est une pathologie complexe impactant la santé tout autant que la vie quotidienne. Dans cet ouvrage, Audrey LNRD et Audrey HVC, fondatrices de Ginette et Josiane, témoignent de leur combat pour mieux comprendre ce trouble dont elles souffrent et livrent les solutions qu’elles ont testées pour mieux vivre avec: –> une alimentation adaptée, notamment grâce à la méthode low FODMAP (un protocole permettant de déterminer les tolérances et intolérances à ces glucides) ; –> une meilleure gestion du stress et des émotions, facteurs favorisant les troubles digestifs, grâce à des pratiques comme le yoga et l’hypnose ; –> une hygiène de vie favorable au bon fonctionnement de l’appareil digestif : activité physique, plats faits maison et produits naturels, sommeil de qualité… Le mot des fondatrices et auteurs : Loin d’être un énième livre médical sur le sujet (nous ne sommes toujours pas devenues gastro-entérologues), nous revenons sans détour, à travers le récit de nos parcours, qui sont aussi un peu les vôtres, sur tout ce qu’implique ce syndrome, bien au-delà des seuls symptômes : l’errance scientifique et médicale, l’impact de nos choix et de nos comportements sur son développement, ses conséquences sociales que l’on oublie bien souvent, l’aubaine parfois qu’il peut représenter pour certains mais aussi et surtout les solutions qui existent pour mieux vivre avec ! Oui, comme le titre l’indique, même si le SII s’apparente plus à un parcours de patience qu’à un parcours de patients, “Vivre en paix avec ses intestins” c’est chiant mais c’est possible !
Dès
Le festin de l’intestin
Le Festin de l’intestin Le Festin de l’intestin est un livre de recettes pauvres en FODMAPs dont la vocation est de donner ou redonner l’envie de manger avec plaisir tout en respectant les recommandations de la Monash University en Australie (référence mondiale pour le régime pauvre en FODMAPs). Ce livre, créé sous l’égide de la Fondation DigestScience et de son département DigestSanté, s’adresse plus particulièrement aux malades atteints du syndrome de l’intestin irritable (SII), des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin demeurant symptomatiques malgré l’efficacité des traitements, mais également à tous ceux présentant des douleurs abdominales et ballonnements chroniques. 50 recettes du quotidien, 12 menus de chef pauvres en FODMAPs et les Incontournables du Placard, le tout en 100 pages illustrées dans un format 21X24 cm. Un allié précieux dans votre quotidien ! Des recettes simples sucrées comme salées, des menus festifs et gastronomiques, adaptés à vos problèmes digestifs mais imaginés pour que le plaisir gustatif soit toujours au rendez-vous. Votre cuisine régalera vos familles et amis et vous retrouverez la convivialité autour de la table. Grâce aux trucs et astuces, votre suivi diététique de la méthode pauvres en FODMAPs sera simplifié. Le Festin de l’intestin, pour retrouver un confort digestif et du plaisir au quotidien ! Le Festin de l’intestin est un livre de recettes savoureuses et pauvres en FODMAPs. Mais qui dit pauvre en FODMAPs ne veut certainement pas dire fade, simpliste et rébarbatif. Exit la monotonie, les repas sans relief et le manque d’inspiration ! Ce livre a été conçu pour répondre à plusieurs besoins, bien souvent exprimés par les personnes victimes des caprices de leurs intestins. Le Festin de l’intestin vous permettra : –>De cuisiner des recettes sucrées et salées originales, pleines de saveurs et qui respectent les principes de la méthode pauvre en FODMAPs développée par la MONASH University* –>De préparer simplement et quotidiennement des repas qui vous permettront de vous faire plaisir tout en favorisant votre bien-être intestinal, mais également de surprendre vos proches avec des menus gastronomiques, –>De (re)trouver du plaisir à cuisiner et à manger de bons petits plats à la maison ou au travail, ou encore la convivialité de repas en famille ou entre amis. Ce livre de recettes a été élaboré avec soin, par le chef de cuisine David Cauderon pour les menus, par “Ginette et Josiane” (nos coachs expertes SII) pour les recettes du quotidien. L’ensemble sous la consuite d’ Oriane Macke-Chaouat, diététicienne spécialisée, diplômée d’État et certifiée par la Monash University (Australie) et du Pr. Pierre Desreumaux, gastroentérologe Président Fondateur de la Fondation DigestScience. Les FODMAPs c’est quoi ? Les FODMAPs sont un ensemble de sucres qui fermentent et sont responsables de certains troubles intestinaux. FODMAPs = (Fermentable by colonic bacteria Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols). Plus simplement, ce sont des glucides de petites tailles, très peu absorbés par l’intestin grêle et qui procurent ballonnements, flatulences, diarrhées… symptômes parfois très invalidants chez certains partients. Et quand je l’ouvre, qu’est-ce que je trouve ? –>Une explication de la méthode pauvre en FODMAPs, –>Les incontournables du placard, les must-have à posséder si vous souhaitez démarrer ou suivre la méthode, –>50 recettes du quotidien, sucrées et salées (petits déjeuners, boissons, snacks, déjeuners ou dîners), –>12 menus de chef (entrée, plat, dessert) Le tout ponctué d’ “Astuces de la diet” et de superbes clichés et illustrations sur 100 pages (format 21×24 cm). Le Festin de l’Intestin sera un allié précieux dans votre quotidien grâce à ses recettes adaptées à vos problèmes digestifs et imaginées pour que le plaisir gustatif soit toujours au rendez-vous !
Dès
Ces articles pourraient vous plaire !
Retrouve ton code de parrainage sur ton espace client
10% de réduction sur leur première commande, 5€ pour toi !